Le philosophe Timothy Morton est connu pour avoir affirmé que la fin du Monde est survenue en avril 1784, mois où l’inventeur britannique James Watt déposa une demande de brevet pour la locomotive à vapeur. Cet événement marque en effet un seuil important, qui marque le moment où l’humanité met le doigt dans l’engrenage qui la mènera à délaisser la puissance de l’eau, du vent et des animaux au profit de celle du charbon et éventuellement du pétrole. Dans son livre intitulé Hyperobjets : philosophie et écologie après la fin du Monde, Morton soutient que le passage à un mode de production gavé par l’énergie des hydrocarbures provoque un changement fondamental dans le rapport qu’entretiennent les humains avec la planète. Jusque là, le « Monde » vivait avant tout dans notre imagination. Il s’agissait d’un construit par lequel il devenait possible de penser la totalité de notre demeure terrestre, mais davantage pour en faire sens que pour agir sur elle. Ceci changea le jour où les industriels décidèrent le mettre le charbon au travail, de lui faire pomper les fonds de mines inondées, tourner les machines des usines et mouvoir les trains et les bateaux qui étendaient toujours davantage les chaines d’approvisionnement de la globalisation capitaliste. Le Monde, soudain, n’était plus une abstraction cosmologique. Il serait dorénavant nécessaire de l’aborder comme un objet concret, matériel, sur lequel les actions humaines peuvent avoir des impacts et qui peut, en retour, avoir des impacts sur les vies humaines.
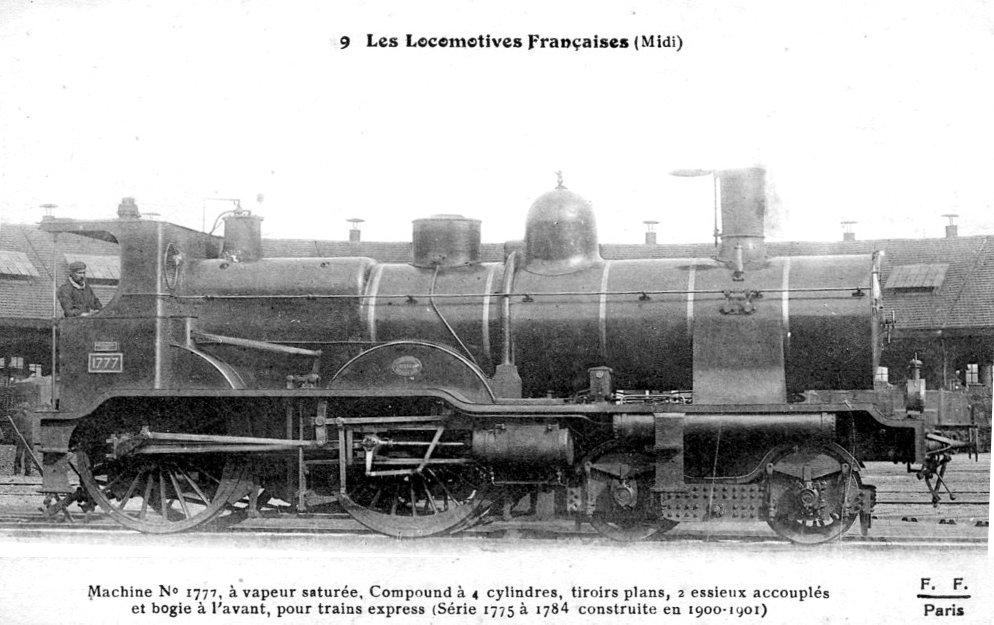
Bien entendu, cette réalisation n’est pas surprenante pour tous les humains également. Les réserves de charbon et de pétrole connues ont mis plus de 300 millions d’années à se constituer. Penser que nous pourrions en brûler une part substantielle en à peine deux siècles et ne souffrir aucune conséquence relève d’une insouciance que seule une classe privilégiée pouvait se permettre. Le reste de la planète était déjà douloureusement familier avec les limites de la capacité porteuse des écosystèmes locaux, régionaux, voire continentaux. Pour la majorité de l’humanité, l’ère des hydrocarbures aura fait naitre un problème d’échelle supérieure, certes, mais qui s’est surtout ajouté à des destructions déjà observées au quotidien depuis longtemps, notamment par l’effet de la déforestation et de la contamination des cours d’eau. Ce qui change avec la pollution par les hydrocarbures est que personne n’échappe aux effets des bouleversements qu’elle provoque. Des interconnexions qui ne pouvaient jusque-là qu’être imaginées deviennent alors des interconnexions concrètes et matérielles liant non seulement les populations humaines entre elles, mais mettant clairement en évidence leur étroite relation avec les écosystèmes de l’ensemble de la planète. Les émissions de C02 d’une usine du Québec contribue à la fonte de la calotte glacière du Groenland, qui a un impact sur les régions côtières de Norvège, et ainsi de suite. Le réseau de relations est si réel et si complexe que la biosphère terrestre, nous dit Morton, peut en être considérée un seul « hyperobjet » que personne ne comprend totalement, mais dans lequel tout le monde est directement impliqué.

Le colonialisme, le capitalisme, l’industrialisation et les dérèglements climatiques sont les dynamiques qui, s’engendrant l’une l’autre, ont été les moteurs de la globalisation des problèmes humains et environnementaux. Ensemble, nous pourrions dire qu’ils constituent le plus grand problème structurel auquel nous ayons jamais été confronté.e.s. Dès les années 1980, l’historien britannique E. P. Thompson parlait d’une structure « exterministe » pour qualifier ce complexe économique, politique et idéologique qui génère de la souffrance humaine – et nous pourrions ajouter de la destruction écologique – non pas par accident mais bien du simple fait de son développement prévisible.

Comment agir sur un (hyper)objet d’une telle ampleur et d’une telle complexité? Ces jours-ci, beaucoup d’attention est accordée aux engagements que prendront les représentantes et représentants des quelques 200 pays prenant par à la COP26. Les cibles de réduction de gaz à effet de serre annoncées seront analysées, extrapolées, commentées. Les gros problèmes demandent certainement de grosses solutions et des centaines de milliards de dollars en investissements « vert » seront sans doute annoncées pour donner une crédibilité aux cibles annoncées. Mais le fait que l’urgence climatique découle d’un problème structurel et non d’une crise conjoncturelle change la donne. La crise peut être gérée par en haut, par dfes mesures exceptionnelles de grande échelle. Mais le problème structurel, lui, demande en plus – et surtout – de reconstruire par le bas.

L’écart apparent entre l’action locale et l’effet global peut parfois donner le vertige. Nous pouvons voir comment une action à petite échelle peut arriver à mitiger les souffrances, à mieux préparer les communautés et à les rendre plus résilientes. Mais pour que cette mobilisation ait un effet sur la structure économique, politique et idéologique exterministe, elle doit elle-même avoir des visées structurantes. Elle doit elle-même chercher faire réseau, à connecter, à inspirer. En un mot, les actions locales peuvent en venir à constituer leur propre hyperobjet, un réseau de relations concrètes, matérielles et complexes au-delà de simples solidarités abstraites. Par la multiplication des alliances de proche en proche, une nouvelle structure se développe. Elle pousse enchevêtrée dans un épais buisson de branches mortes, cherchant le soleil dans toutes les directions possibles.


