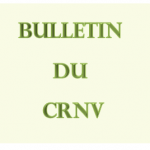La violence économique
Par Martin Hébert
Il y a des moments de subversion qui sont patiemment organisés et chorégraphiés. D’autres sont spontanés et surviennent aux endroits et aux moments les plus inattendus. J’ai souvenir, en particulier, d’une tribune téléphonique sur les ondes de la radio de la CBC un certain 24 décembre. Le thème se voulait léger : Quels sont vos projets pour le temps des Fêtes? Comme attendu, les appels commencèrent à défiler; des auditrices et des auditeurs se mirent à décrire leurs plans de festivités. Soupers en famille, réveillon, voyages, etc. étaient décrits avec anticipation et sur un ton jovial.
Mais tout d’un coup, ce tableau bucolique commença à s’assombrir. Une femme, en larmes, se mit à décrire la honte qu’elle éprouvait à se trouver obligée de choisir entre manger ou offrir à ses enfants les cadeaux qu’ils souhaitaient. Ce témoignage franc et émouvant, dans lequel résonnait une souffrance profonde, fit sauter les verrous. L’appel suivant, puis un autre et un autre encore, se succédèrent avec des récits et des dilemmes semblables. C’est la souffrance qui se fit alors entendre empruntant le même refrain : « pression, stress et honte à ne pouvoir garder le rythme ». On souffre à ne pouvoir se joindre à une grande fête de la consommation attisée avec frénésie dans l’espace médiatique pour plusieurs mois dès le lendemain de l’Halloween.
Il est rare de voir ce genre de désarroi exprimé sur la place publique au Canada. Habituellement, les représentations de la précarité financière sont mieux orchestrées. Aussitôt aura-t-on tendu le micro à une personne dans le besoin, qu’on enchainera avec la recette toute faite pour palier à la situation. Ou encore, on atténuera l’expérience de la souffrance économique sous des statistiques et indicateurs.
Entre temps, les recours aux banques alimentaires explosent. Les demandes de paniers auraient crû de près de 10% au cours de la dernière année seulement. L’approvisionnement des banques alimentaires, lui, devient de plus en plus difficile, les grossistes tentant d’extirper la dernière goutte de profit possible de leurs stocks en les vendant en lots à des commerces de liquidation au lieu de les donner à des organismes caritatifs. Ce sont là des tendances hautement préoccupantes, mais ce n’est là qu’une partie de la réalité.
Une autre facette de cette souffrance a également fait surface ce jour-là sur les ondes de la CBC : le mal-être vécu dans l’expérience intime par bien des gens, au moins jusqu’à ce qu’il éclate sur la place publique comme en cette émission que les producteurs voulaient légère et bon enfant. Les économistes qualifieraient ce mal-être d’ « externalité », de conséquence non souhaitée mais inévitable dans le processus d’accumulation capitaliste, au même titre que la pollution ou les accidents de travail. La société est même portée à en faire une condition médicale, une forme d’anxiété à traiter. On en fait certainement une affaire de gestion des finances personnelles, par laquelle le problème est parcellisé en « cas » uniques et individuels. Nous savons cependant que les racines de cette détresse sont plus profondes qu’une simple question de gestion des indicateurs macro ou micro-économiques.
Dès les années 60, dans La société du spectacle (1967), Guy Debord présenta une analyse qui deviendra la précieuse clé pour comprendre les effets profondément aliénants de la publicité. Il a mis au jour la manière dont la projection de l’identité et de l’individualité dans les habitudes de consommation cache en fait un rapport inverse et toxique par lequel ce sont plutôt la marchandise et les expériences que nous achetons qui en viennent à nous définir. Elles « éduquent » les consommatrices et les consommateurs, comme on dit. Qui plus est, ajoutera Jean Baudrillard quelques années plus tard dans La société de consommation (1970), cette construction identitaire est délibérément maintenue dans un état de perpétuelle instabilité par toute une industrie consacrée à stimuler la demande. La consommation devient à la fois la mesure de notre différence par rapport à l’entourage et celle de notre propre évolution personnelle. Conserver ses vieilles choses trop longtemps passe ainsi pour stagnation, sinon régression personnelle et sociale.
L’expression publique des émotions générées par ce système d’insatisfaction perpétuée mérite attention et respect. La raison pour laquelle l’émission radio de la CBC fut surprenante est que la norme continue d’être la répression de ces émotions, leur refoulement dans l’intime ou dans le cabinet de spécialistes financiers ou de la santé. Mais l’expression de la honte, du découragement, de la colère, de la tristesse, de l’anxiété nous donne à voir les effets d’une économie qui inflige des blessures réelles aux personnes. Les souffrances causées par cet écartèlement ne sont pas conjoncturelles, elles ont des racines structurelles. Le premier pas pour nous en affranchir est de faire de la place à l’expression publique de ce mal-être.
La COP 15 : sans convaincre
La 15ème Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (COP 15) organisée à Montréal (au Canada) s’est terminée le 19 décembre 2022, apparemment, loin d’avoir atteint son objectif principal d’ « amener tous les pays à accepter de protéger près du tiers des terres et des océans du monde avant la fin de la décennie ». Mais aussi, elle aura simplement échoué au regard des débats qui sont restés sans conclusion, notamment concernant la manière dont cet objectif devrait être financé, des désaccords sur la création d’un nouveau fonds pour la biodiversité et la manière dont il sera géré, etc.
La Convention sur la diversité biologique a été présidée par la Chine (qui aurait dû en être le pays hôte). Le gouvernement chinois, qui n’avait pas ouvert ses frontières aux voyageurs internationaux, a consenti à ce qu’elle se tienne en terre canadienne. Elle s’est tenue à Montréal et sa langue de communication fut essentielle ment l’anglais. Les partis d’opposition du Québec n’ont pas raté l’occasion qu’offrait le contexte pour interpeler le premier ministre François Legault dont le gouvernement ne jure que par la croissance. « L’étalement urbain (alourdissant le bilan carbone) et la construction de nouveaux barrages constituent les menaces sur lesquelles il faut agir dans l’immédiat si l’on veut préserver les espèces menacées, les terres agricoles », ont estimé les partis d’opposition et en particulier, le parti Québec solidaire. Les dirigeants de l’opposition ont pointé du doigt le gouvernement caquiste qui fait traîner dans ses bureaux pendant des années des projets d’« aires protégées » et continue d’annoncer la construction de nouveaux barrages, synonymes de pression sur la biodiversité.
Mary-Wynne Ashford : une grande militante antinucléaire nous a quittés
Mary-Wynne Ashford s’est éteinte le 19 novembre 2022 à l’âge de 83 ans. Depuis longtemps considérée comme une voix pour la paix, elle était devenue une inspiration pour tous ceux et celles qui l’ont connue.
Mary-Wynne Ashford, médecin à la retraite, spécialiste de soins à domicile et des soins palliatifs à Victoria était également professeure associée à l’Université Victoria en Colombie Britannique. Elle est devenue active dans la lutte pour le désarmement nucléaire après avoir entendu le discours de Dr. Helen Caldicott au sujet de la guerre nucléaire.
Pendant 37 ans, elle a pris parole à l’international et produit de nombreux écrits sur la paix et le désarmement. Elle a été, entre autres, co-présidente de l’Association internationale de Médecins pour la prévention de la Guerre nucléaire (IPPNW) de 1998-2002 et présidente de Médecins canadiens pour la prévention de la guerre nucléaire de 1988 à 1990. Son livre principal Enough Blood Shed : 101 Solutions to Violence, Terror, and War, a été traduit dans plusieurs langues dont le japonais et le coréen. Elle a remporté de nombreux prix parmi lesquels la médaille de la Reine (remportée à deux reprises), le prix d’excellence des médecins de la Colombie Britannique en 2019. Elle a enseigné en ligne un cours gratuit intitulé Global Solutions for Peace, Equality, and Sustainability, un cours subventionné par Next Gen U and IPPNW Canada. Le cours portait essentiellement sur la réforme des Nations Unies pour accroître sa capacité de faire face aux crises existentielles qui sont les nôtres aujourd’hui.
Sur la taxation des superprofits : Le débat entravé en France
Lors du vote du budget à l’Assemblée nationale, le gouvernement français a recouru à l’article 49.3 de la Constitution pour empêcher le débat parlementaire autour de la taxation des superprofits des entreprises. Il s’agit d’un article de loi grâce auquel « le conseil des ministres peut décider seul de l’adoption d’une loi sans passer par le Parlement » ou opposer à un projet de loi de l’Assemblée un autre sur lequel le conseil de ministre se met d’accord. Des regroupements citoyens se mobilisent pour exiger le retrait de cette mesure qui constitue une entrave au débat parlementaire. Selon, le site du Mouvement pour une Alternative Non Violente, « l’Alliance écologique et sociale a déposé une pétition sur le site du Sénat afin de remettre le sujet des superprofits à l’agenda du parlement ». L’objectif est d’atteindre les 100 000 signatures, pouvant obliger le Sénat à examiner la demande et pouvoir déposer une proposition de loi et remettre le sujet de la taxation des superprofits dans les débats législatifs. « C’est donc une opportunité majeure pour la justice sociale et écologique !», déclarent les dépositaires de la pétition (AequitaZ, Les Amis de la Terre France, Attac France, La CGT, La Confédération paysanne, Greenpeace France, Mouvement pour une Alternative Non-Violente, Notre Affaire à Tous, Oxfam France, Réseau action Climat, Union syndicale Solidaires, etc.).
La taxation entérinée par le gouvernement ne peut rapporter que 200 millions d’euros en France par année, alors qu’un plan ambitieux de taxation des superprofits iraient chercher jusqu’à 20 milliards d’euros, des moyens substantiels pour répondre à la crise environnementale touchant les plus vulnérables et à l’inflation. Un sujet qui n’est pas sans intérêt au Québec et au Canada.
Un feuillet d’information sur les déchets nucléaires
Préparé par le Dr Gordon Edwards
Du Regroupement pour la surveillance du nucléaire (CCNR).
Déchets nucléaires : Qu’est-ce qu’ils sont ? … et qu’est-ce qui ne va pas avec eux ?
Des réponses en sept points : Radioactivité; Effets médicaux de l’exposition aux rayonnements ; Com portement des matériaux radioactifs; Résidus d’uranium; Produits de fission; Plutonium et autres éléments transuraniens; Produits d’activation.
Violence armée 2 : Des outils de préventions
Les armes à feu les plus vicieuses, les plus dangereuses à entrer au Canada proviennent des États-Unis, où la possession d’armes est considérée comme un droit protégé par la constitution. (…) Nous sommes en devoir d’exiger que tout fabricant d’armes autorisé à distribuer ses produits au Canada, ait obligatoirement un siège social au Canada et soit assujetti aux lois canadiennes. Il devrait fabriquer des armes en territoire canadien et être sujet à des poursuites, comme toute entreprise qui porte une responsabilité sur l’utilisation de ses produits.
Violence armée : Désamorcer la combinaison mortelle « armes à feu et tendance »
Par Normand Beaudet
La lutte à la violence armée redevient un enjeu de taille pour la population et pour les organisations citoyennes. Le problème n’est pas aussi nouveau qu’on serait porté à le croire cependant même si les événements des derniers jours feraient penser que nous vivons un climat sans précédent. Depuis des décennies, des travaux s’effectuent au Canada et aux États-Unis par des coalitions qui planchent sur les possibilités de limiter les violences favorisées par l’accès facile à des armes à feu. Suite à la tuerie de l’École polytechnique en décembre 1989, le CRNV a établi des liens avec l’organisme américain Coalition to Stop Gun Violence, devenu maintenant The Center for gun violence solution, partie prenante du Johns Hopkins Center of Public Health (maintenant basé à Baltimore) dont il utilise encore l’importante documentation. Nous en tirerions aujourd’hui un plan d’action stratégique en deux volets. Il s’agit d’une part de désamorcer la combinaison mortelle armes à feu et tendance suicidaire.
La tendance au suicide-spectacle de notre époque, souvent précédé par un massacre d’âmes innocentes pour se donner toute l’ampleur voulue, est facilitée par l’omniprésence des armes à feu. Le phénomène suicidaire et la prolifération des armes s’alimentent mutuellement et doivent être examinés conjointement. D’autre part, des outils d’analyse à la portée de services dédiés à la sécurité publique peuvent contribuer énormément à la résolution du problème en travaillant à la limitation, la réduction et même le contrôle de la possession des armes à feu.
Suicide et armes à feu Le suicide est une crise de santé publique en Amérique. Elle n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie malgré un petit répit entre 2018 et 2019. Le suicide (quelle qu’en soit la méthode) continue d’être la 10ème cause de décès dans le pays, et les armes à feu continuent de re présenter la moitié de tous les suicides. Il est aisé de démontrer que l’accès aux armes à feu augmente le risque de suicide, que l’accès à une arme à feu à la maison multiplie par plus de trois les risques de suicide et que leur disponibilité rend les tentatives de suicide plus meurtrières.
Quand les armes à feu ne sont pas disponibles, la personne à risque de suicide est beaucoup plus susceptible de survivre même si elle tente d’utiliser une autre méthode : retarder une tentative de suicide peut permettre aux crises suicidaires de passer; mettre du temps et de l’espace entre une personne susceptible d’attenter à sa vie et des moyens létaux, en particulier les armes à feu, augmente les chances qu’elle survive; les crises suicidaires culminent assez rapidement pour de nombreuses personnes et les chances de pouvoir bénéficier d’une intervention réduisent certainement le risque de mort. Par contre, l’utilisation d’une arme à feu lors d’une tentative de suicide signifie souvent qu’il n’y a pas de seconde chance.
Les armes à feu augmentent le risque de suicide pour toute personne vivant à la maison, y compris les enfants. Une étude récente a révélé que la possession d’armes à feu à la maison était le meilleur prédicteur du suicide chez les jeunes. Pour chaque augmentation de 10 points de pourcentage du nombre estimé de possessions d’armes à feu dans les ménages, le taux de suicide chez les jeunes âgés de 14 à 19 ans a augmenté de près de 27 %.
Les armes à feu et le suicide sont une combinaison mortelle. Le fait d’avoir une arme à feu ne rend pas plus suicidaire, mais pouvoir y accéder plus facilement augmente le risque de mort pour une personne qui tente de le faire.
D’autre part, nous avons déjà relevé le lien qui, sûrement, existe entre la tendance suicidaire et les tueries de masse. Une des affirmations que nous faisions suite aux attaques de la dernière décennie (les attaques à St-Jean-sur-Richelieu, au parlement à Ottawa, les tueries à Charlie Hebdo et dans une épicerie en pleine capitale française, etc.) était que la majorité des actes meurtriers à l’arme à feu étaient souvent des effets de crises suicidaires, déguisées ou mises à la sauce du jour, c’est-à-dire adaptée au monde de la cyber communication. L’individu souffrant réalise le fort potentiel médiatique d’un tel geste meurtrier. Il perçoit l’acte comme un moment vengeur qui, en plus, fera en sorte que les récriminations qu’il associe à sa crise soient largement diffusées.
Outils de contrôle
Le contrôle des Armes d’assaut et chargeurs grande capacité constituent un recours qu’il ne faut pas négliger. Les armes d’assaut sont des armes à feu avec des caractéristiques de style militaire. Les chargeurs de grande capacité permettent le tir de nombreux projectiles en peu de temps. Dotées de certaines caractéristiques qui facilitent le tir précis de nombreuses balles en peu de temps, ces armes sont conçues dans un seul but : tuer le plus de personnes possibles le plus rapidement possible en situation de guerre. Nous savons qu’elles ont été utilisées dans les fusillades les plus meurtrières de notre pays.
Limiter, réduire, voire contrôler leur utilisation est envisageable. Des outils de préventions comme les Lois sur les risques extrêmes (LRE), la vérification universelle des antécédents, le micro-marquage des armes, etc. sont parmi les moyens dont les services publics peuvent se servir pour agir efficacement en alliant prévention et intervention de manière sûre.
(Au sujet des recommandations sur les moyens de contrôle, lire le texte sur notre site : www.nonviolence.ca)
Églises éco-refuges
Le projet visant à stimuler la transformation des églises en mal de vocation en lieux de refuge de proximité fait du chemin. Depuis deux ans, le CRNV a facilité le travail de comités de réflexion sur le projet, concouru à la conceptualisation de l’approche et à la production d’outils d’information (un plan architectural, articles et vidéos d’information, fiches techniques sur les vocations envisageables, inventaire de sources éventuelles de financement, un guide pour la requalification à des fins d’Éco-Refuges).
Avec les collaborateurs actifs dans le projet, nous en sommes à une phase décisive. Il s’agit maintenant d’évaluer la possibilité de démarrer des expérimentations concrètes de l’approche.
Au cours du mois de novembre, une tournée de visites a été organisée sur une dizaine de sites des églises répondant aux critères de base de conversion en éco refuges. Environ 20 autres sites ont été répertoriés. Ces sites constituent des lieux potentiels d’implantation d’éco-refuges dont le modèle pourra se répandre à une plus grande échelle.
Nous sommes donc à la recherche de sources de financement qui permettront d’évaluer la faisabilité : l’implantation des premières structures conformes aux nouvelles vocations.
Front commun pour une transition énergétique (FCTE)
Avec son projet d’éco-Refuges, le CRNV observe de manière intéressée l’actuel développement du FCTE.
La plus large coalition d’organismes de la société civile québécoise militant en faveur de la transition énergétique continue de s’élargir et de se donner des assises par des projets concrets.
L’organisation a bénéficié d’un imposant soutien financier de la part de fondations philanthropiques de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux. Ce qui lui donnera les coudées franches dans la mise en place de sa feuille de route Collectivité Collectivité ZéN (Zéro émission Nette). En novembre dernier, plusieurs régions du Québec ont pu annoncer le lancement officiel de leur Collectivité ZéN, la Gaspésie, les MRC de L’Assomption et de D’Autray, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville à Montréal et la région de l’Outaouais. Toutes ces collectivités ont annoncé prendre le chemin de la transition socio-écologique avec le FCTE.
À sa deuxième année d’existence, ce projet de grande envergure vise à réunir les différentes organisations clés d’un même territoire pour entreprendre la décarbonation de leur collectivité, dans une perspective de justice sociale et d’alliances avec les Premiers Peuples, franchit aujourd’hui une nouvelle étape importante. Ces quatre nouvelles Collectivités ZéN (zéro émission Nette) viennent rejoindre celles de Laval, de Lachine, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avaient été lancées il y a un an. Celles-ci ont déjà entamé les étapes de démarrage et sont actuellement en cours de structuration, en plus d’avoir commencé à poser un diagnostic sur les besoins de leurs territoires en matière de transition avec les groupes et communautés locales. Les Collectivités Zén constituent des lieux où peuvent être promues les vocations d’éco-refuges.
Regroupement Vigilance hydrocarbures Québec
Les membres de notre équipe ont également suivi de près les activités du RVHQ. C’est le 27 novembre dernier, lors de son Assemblée générale annuelle que ce regroupement d’organismes citoyens a effectué le lancement de la campagne « Pas de méthane dans ma cabane ». Une bonne vingtaine de représentants d’organismes répartis sur l’étendue du territoire québécois ont pu constater le travail accompli par les membres de l’organisation. Une demi-douzaine de fiches informatives et des lettres-types s’adressant aux organismes publics ont été diffusées afin de faciliter la mobilisation citoyenne.
Le déploiement de la campagne devrait pouvoir se faire dès le début de l’année 2023. Chose certaine, grâce au regroupement les militants ont en main une bonne gamme d’outils.
Conseil d’administration
Depuis quelques années le Centre mène une campagne de recrutement de membres pour le développement de différents dossiers d’éducation à la non-violence. Les personnes qui adhèrent comme membres sont éligibles à des postes du Conseil d’administration.
Cette année, c’est Ananda Proulx, Étudiante en sciences politiques à l’Université du Québec à Montréal qui a rejoint l’équipe du Centre. Ananda Proulx a découvert le CRNV à l’occasion de son emploi d’été en 2022. Elle siège désormais comme administratrice au Conseil d’administration aux côtés de : Alexandre Vidal (Président), Martin Hébert (vice-président), Normand Beaudet (Administrateur), Claire Adamson (Trésorière), Shimbi Katchelewa (Secrétaire). Au cours de son emploi d’été, Ananda a principalement travaillé à la finalisation de documents pour la première campagne pour les Églises Éco-Refuges.